Approche sexo-corporelle : fondements et bases physiologiques
1. Les fondements de l’approche sexo-corporelle
A. Présentation de la vision intégrative, développementale et interactive de l’approche
L’approche sexo-corporelle repose sur une vision intégrative : elle considère l’être humain dans l’unité de ses dimensions corporelle, affective, cognitive, relationnelle et symbolique. Elle est également développementale, en ce sens qu’elle intègre l’histoire du sujet (corporelle et sexuelle), et interactive, car la sexualité ne se vit jamais en dehors du lien à soi et à l’autre.
Elle postule que la sexualité n’est pas seulement un comportement, mais un système vivant composé de structures physiologiques, de mémoires corporelles, d’émotions, de représentations, d’apprentissages et de dynamiques relationnelles. Elle vise à restaurer une sexualité libre, incarnée et évolutive, dans le respect du rythme du corps.
B. Présentation des axiomes et fondements de l’approche
Parmi les fondements clés de l’approche, on retrouve les lois du corps (globalité, rythmicité, progressivité, enracinement, mémoire corporelle, alternance tonique…), la reconnaissance de la fonction excitatoire comme pilier de la santé sexuelle, et l’importance du mouvement sexuel dans l’organisation du corps.
L’approche repose aussi sur un principe thérapeutique fondamental : on ne peut pas transformer une difficulté sexuelle uniquement par la parole ou la pensée — il faut que le corps participe au processus de changement. Ainsi, la dimension corporelle n’est pas décorative, elle est thérapeutique à part entière.


2. Présentation générale du modèle de santé sexuelle
Le modèle de santé sexuelle développé par Jean-Yves Desjardins est un cadre conceptuel qui permet d’analyser et de soutenir les différentes composantes de la sexualité humaine, qu’elles soient physiologiques, psychologiques, relationnelles ou symboliques.
Ce modèle comprend notamment :
des composantes physiologiques (excitation, orgasme, désir…),
des composantes personnelles (imaginaire, plaisir, sentiment d’appartenance…),
des composantes cognitives (croyances, valeurs…),
des composantes relationnelles (communication, séduction, sentiment amoureux…).
Ce modèle offre une lecture dynamique de la sexualité, orientée vers la santé, la liberté et la réconciliation entre le sexe et la personne entière.
3. Le développement sexuel de l’enfant
Ce thème explore l’émergence progressive de la sexualité humaine dès l’enfance, en soulignant que la sexualité n’est pas réductible à la génitalité adulte. Le développement sexuel est vu comme un processus de construction identitaire et corporelle, influencé par les expériences sensorielles, affectives, éducatives et relationnelles.
L’enfant découvre peu à peu son corps, ses sensations, ses zones érogènes, ses limites, son plaisir, dans une dialectique entre exploration de soi, socialisation, interdits et modélisation parentale. Le respect du rythme développemental est essentiel pour poser des bases saines à l’épanouissement sexuel adulte.
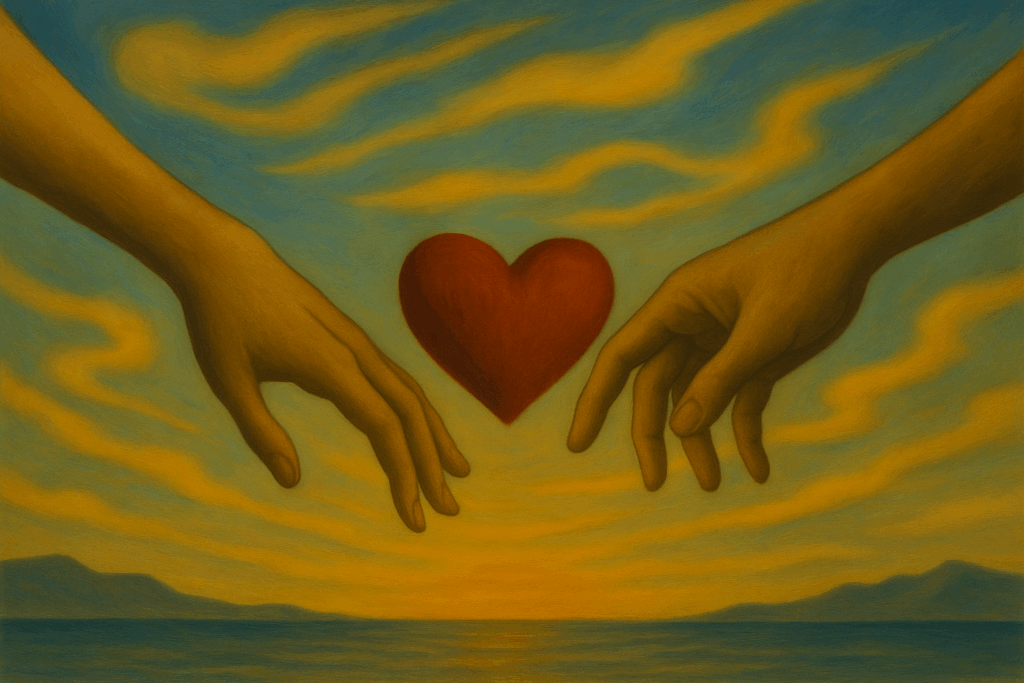
4. Les composantes physiologiques du modèle de santé sexuelle
Ce chapitre présente les éléments neurophysiologiques et corporels qui sous-tendent l’activité sexuelle humaine. Il s’agit d’outils d’observation, de compréhension clinique et d’intervention, dans une perspective concrète et incarnée.
A. La fonction excitatoire
La fonction excitatoire est le noyau physiologique de la sexualité humaine. Elle désigne la capacité du corps à s’éveiller, à se mobiliser, à vibrer, à jouir. Elle implique des processus réflexes (vasodilatation, lubrification, érection…), mais aussi une expérience subjective de plaisir, de montée d’énergie, de mouvement interne.
L’évaluation de la fonction excitatoire est centrale pour repérer les troubles sexuels (éjaculation rapide, anorgasmie, frigidité, blocage de l’élan…). Le travail en sexo-corporel consiste souvent à rééduquer, réintégrer ou enrichir cette fonction excitatoire.
B. Les sources d’excitation sexuelle
Les sources d’excitation désignent les portes d’entrée qui permettent au plaisir de s’éveiller : contact physique, imaginaire, regard, voix, odeur, mouvement, représentation symbolique, climat relationnel…
Une personne peut être excitée principalement par la peau, le fantasme, le sentiment amoureux, la transgression, le visuel, ou encore la lenteur. Identifier ces sources permet de comprendre le langage propre du plaisir chez chaque individu.
C. Les modes d’excitation sexuelle
Les modes d’excitation désignent la forme que prend le processus excitatoire, selon l’histoire corporelle de la personne. Jean-Yves Desjardins a décrit plusieurs modes typiques : génital, mécanique, archaïque, imaginaire, ondulatoire, etc.
Chaque mode a ses forces et ses limites. Le rôle du thérapeute n’est pas d’imposer un idéal, mais d’aider la personne à reconnaître son mode, à l’élargir ou à le réconcilier avec son corps et son désir.
D. Spécificité de la fonction excitatoire de la femme
La fonction excitatoire féminine est multifocale, ondulatoire, complexe, souvent dépendante de l’environnement sensoriel, affectif et relationnel. Elle est marquée par une grande plasticité, mais aussi par une vulnérabilité au stress, à la culpabilité et à l’auto-observation critique.
L’accompagnement vise souvent à désamorcer le contrôle, à restaurer la confiance corporelle, à éveiller le bassin et à relier le sexe au reste du corps.
E. Spécificité de la fonction excitatoire de l’homme
La fonction excitatoire masculine est souvent plus localisée, rapide, génitale, mais elle est également influencée par le regard de l’autre, la performance, les croyances de virilité. Elle peut être entravée par des schémas mécaniques ou des fragilités narcissiques.
L’approche sexo-corporelle permet de réconcilier l’homme avec son sexe, de restaurer une excitation incarnée et sensible, et d’élargir son plaisir au-delà de l’orgasme.
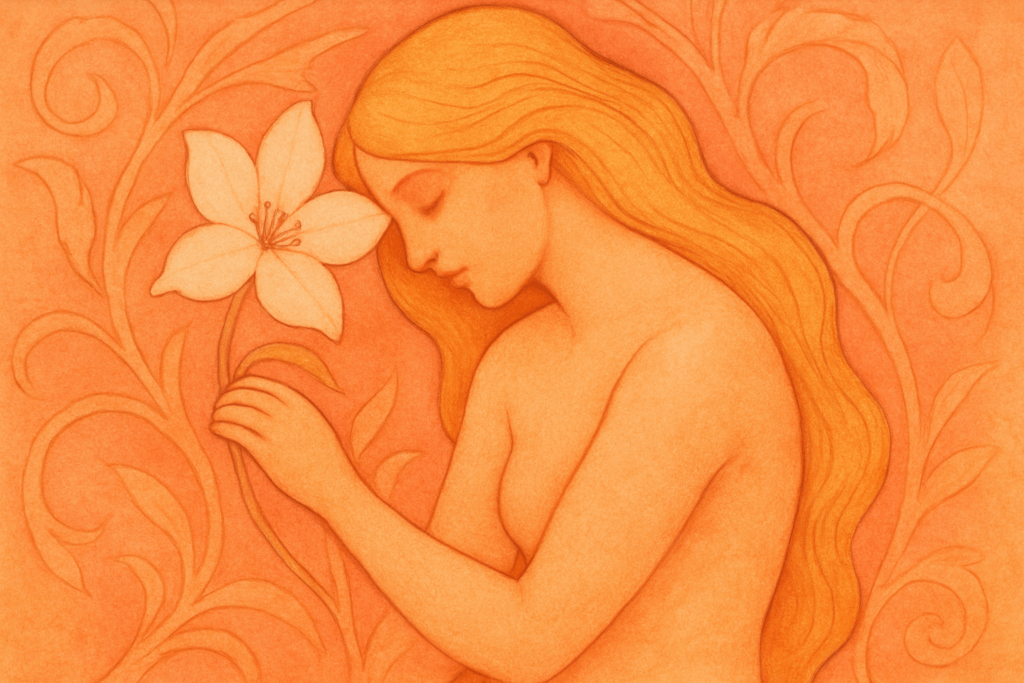

5. Initiation aux habiletés corporelles en lien avec l’approche sexo-corporelle
Les habiletés corporelles sont les capacités du corps à sentir, bouger, respirer, s’exprimer, se relâcher, s’ancrer et se relier. Elles constituent la base du travail sexo-corporel, car elles permettent de réhabiliter le corps comme sujet du plaisir et de la relation.
Habiletés corporelles de base
Ces habiletés sont souvent les premières à explorer, car elles conditionnent la capacité du corps à porter l’excitation, à l’exprimer, à la soutenir.
A. Exploration des lois du corps (rythmes, tensions musculaires, espace)
Les lois du corps (rythmicité, globalité, mémoire corporelle, alternance tonique…) sont des principes naturels de fonctionnement. S’y reconnecter permet de sentir la logique du corps, de l’écouter, de travailler avec lui et non contre lui.
B. Différents types de respirations
Le souffle est le lien entre l’inconscient, le désir et le corps vivant. Respirations hautes, abdominales, circulaires, alternées… chaque type de respiration a un effet sur l’excitation, le tonus, la détente, l’expression émotionnelle.
C. Centration, posture, démarche
Se recentrer, se verticaliser, retrouver une démarche souple et expressive, ce sont des gestes fondamentaux pour habiter pleinement son corps. Cela favorise aussi la confiance, la présence à soi, la séduction naturelle.

