Les composantes personnelles, cognitives et relationnelles de la santé sexuelle
1. Les composantes personnelles du modèle de santé sexuelle
Ces composantes renvoient à ce que la personne ressent, imagine, désire et exprime dans sa sexualité. Elles traduisent la manière dont l’individu vit subjectivement son expérience sexuelle, au croisement de son histoire, de son corps, de son imaginaire et de son affirmation de soi.
1. Le sentiment d’appartenance à son sexe biologique
Il s’agit du ressenti profond d’être homme ou femme à travers son corps, au-delà du genre social ou de l’identité psychique. Ce sentiment est corporel, sensoriel, postural, pulsionnel. Il peut être solide, fragile, ambivalent, conflictuel. L’approche sexo-corporelle permet de réhabiliter cette appartenance à travers des gestes, des ancrages, des rituels corporels.
2. Le plaisir sexuel
Le plaisir n’est pas une simple réaction physiologique. C’est un langage du corps qui traduit l’accord entre la sensation, l’émotion, le désir et le contexte. Le plaisir sexuel peut être inhibé par la honte, la peur de perdre le contrôle, les conditionnements. L’accompagnement vise à réconcilier la personne avec le droit au plaisir, à partir du vécu corporel.
3. L’imaginaire sexuel
C’est la capacité à fantasmer, à scénariser, à se représenter l’acte sexuel sous forme symbolique ou narrative. L’imaginaire sexuel structure l’excitation, donne du relief à l’élan, mais peut aussi la couper du corps si elle est trop exclusive. Le travail sexo-corporel consiste à relier l’imaginaire au sensoriel, à l’éprouvé.
4. Le désir sexuel
Le désir est un mouvement vers l’autre ou vers soi. Il peut être spontané, réactif, cyclique, fragile ou conflictuel. En sexo-corporel, on s’intéresse à la manière dont le corps porte, empêche ou module le désir. Il ne s’agit pas de forcer le désir, mais d’en réhabiliter les conditions corporelles, affectives et relationnelles.
5. L’assertivité sexuelle
C’est la capacité à exprimer ses besoins, ses limites, ses désirs dans le lien sexuel. Elle suppose un alignement entre le corps, la parole et le désir. Beaucoup de troubles sexuels proviennent d’un défaut d’assertivité : soumission, évitement, faux consentement. L’accompagnement vise à incarner une présence sexuelle vivante, claire et ajustée.
6. Les codes d’attraction sexuelle
Chaque personne est sensible à des signaux particuliers qui activent l’élan érotique : voix, vêtements, attitudes, symboles… Ces codes peuvent être enrichissants ou limitants, selon leur origine (ex : fétichisme exclusif). Le travail clinique permet de déconstruire les rigidités et d’ouvrir le champ de l’excitabilité.
7. L’intensité émotionnelle
La sexualité n’est jamais neutre émotionnellement. Elle engage des affects (tendresse, peur, honte, excitation, amour, frustration…). Le niveau d’intensité émotionnelle toléré dans l’érotisme est propre à chacun·e. En sexo-corporel, on cherche à rendre au corps sa capacité à contenir, exprimer et traverser cette intensité sans rupture ni défense.
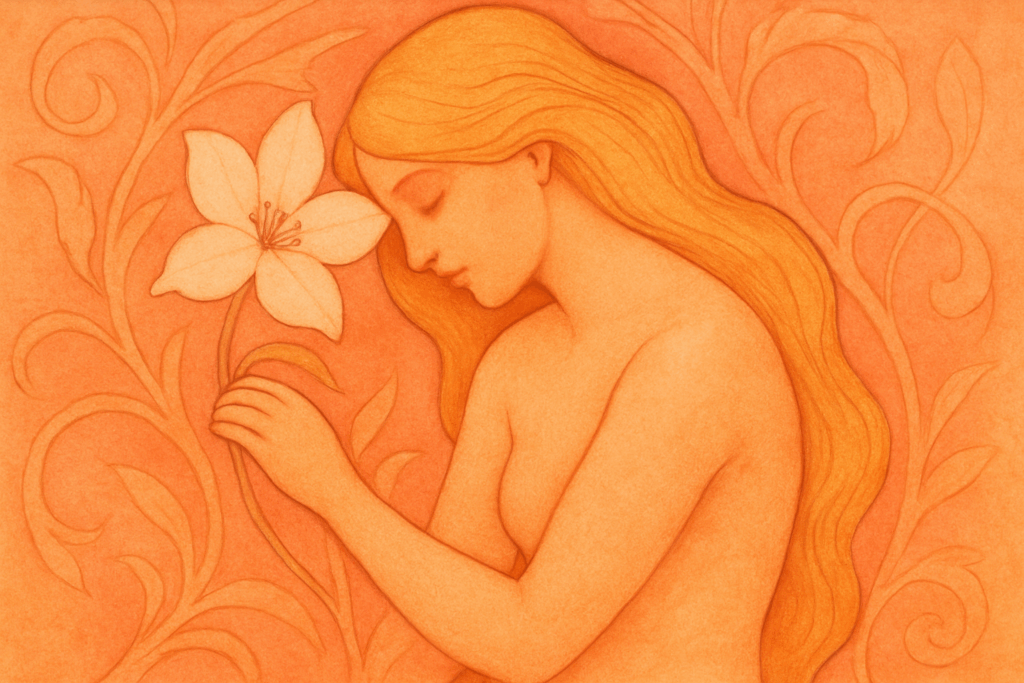

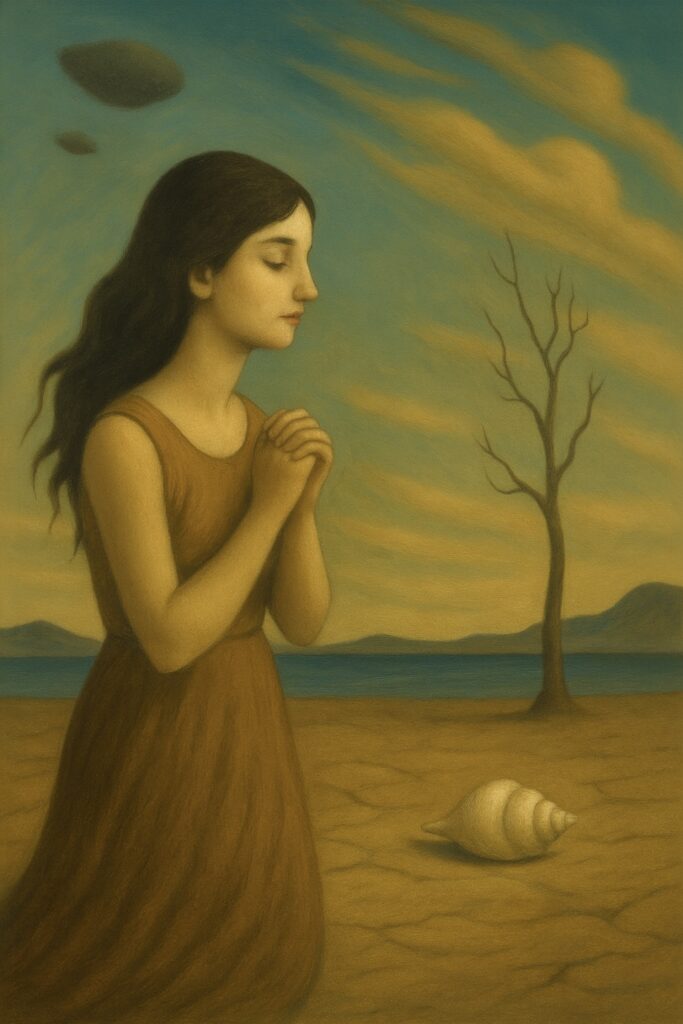
2. Les composantes cognitives (système de pensées) du modèle de santé sexuelle
Ces composantes structurent la perception que la personne a de la sexualité, de son corps, de son identité. Elles sont influencées par l’éducation, les croyances culturelles, les expériences et les discours intériorisés.
2.1. Les connaissances
Connaître son anatomie, les étapes de l’excitation, les réponses sexuelles… est fondamental pour sortir de la confusion et de la peur. La psychoéducation est un pilier de l’intervention : elle redonne du pouvoir à la personne, éclaire les enjeux, ouvre des perspectives.
2.2. Les croyances
Les croyances sexuelles limitantes (ex : “les hommes veulent toujours”, “une femme bien ne désire pas”, “le sexe c’est sale”) conditionnent les comportements. Le travail thérapeutique les identifie, les déconstruit et les reformule dans un cadre plus libre et incarné.
2.3. Les idéologies
Les idéologies sexuelles sont des systèmes de représentation plus vastes (patriarcat, romantisme idéalisé, hétéronormativité, performance pornographique…). En prendre conscience permet de distinguer ce qui vient de soi et ce qui est hérité.
2.4. Les jugements de valeur
Le corps sexué est souvent soumis à des jugements (“je suis trop lent·e”, “pas assez excitant·e”, “trop dominé·e”). Ces jugements rigidifient le corps et freinent l’érotisme. Les séances permettent de travailler l’acceptation, la bienveillance et la réconciliation avec le corps désirant.
3. Les composantes relationnelles du modèle de santé sexuelle
La sexualité se vit rarement seul·e. Elle se joue dans l’échange, le contact, la co-création, la présence à l’autre. Ces composantes relationnelles sont essentielles pour une sexualité vivante et nourrissante.
1. Le sentiment amoureux
Il s’agit de l’attachement affectif et érotique à un partenaire, avec ses enjeux de proximité, de fusion, d’altérité, de loyauté, de vulnérabilité. Il influence profondément l’excitation, le désir et le plaisir. Le sexo-corporel explore comment le corps exprime ou refoule l’amour.
2. La communication
Parler de sexe, d’envies, de fantasmes, de limites, suppose un vécu de sécurité, d’assertivité et de lien. Le corps parle aussi : par les regards, les gestes, les silences. Développer une communication érotique fluide et incarnée est un axe thérapeutique fondamental.
3. La séduction
Séduire, en sexo-corporel, c’est se rendre visible, présent·e, désirant·e dans son corps vivant. Ce n’est ni manipulation ni mascarade, mais expression incarnée de son élan. Elle engage le regard, la posture, la vibration. Le travail consiste à réhabiliter la séduction comme mouvement de lien.
4. Les habiletés érotiques
Elles regroupent les capacités à sentir, toucher, caresser, moduler, respirer, explorer, improviser… dans le plaisir partagé. Elles s’apprennent, se développent, se réactivent. Le sexo-corporel les entraîne comme des ressources créatives au service du plaisir.

4. Initiation aux habiletés corporelles en lien avec l’approche sexo-corporelle
Ce volet complète celui du module 1 en introduisant les habiletés corporelles intégrées, plus complexes car elles engagent la coordination, la fluidité et l’expression du plaisir.
Habiletés corporelles intégrées
Ce sont les habiletés qui traduisent une maîtrise souple et vivante du corps dans la relation érotique. Elles s’expriment dans l’élan, l’abandon, la présence, la séduction.
1. Mouvement de la double bascule
C’est la coordination de la bascule du bassin et du haut du corps, en vague continue. Elle symbolise l’intégration de l’élan sexuel et de l’élan relationnel. Ce mouvement réveille la jouissance ondulatoire.
2. Fluidité
La fluidité désigne la capacité du corps à bouger sans rupture, sans tension excessive, dans un rythme sensuel, ajusté, expressif. Elle reflète une sexualité habitée, libre, connectée au plaisir.
3. Lâcher-prise, abandon
L’abandon corporel n’est pas passivité : c’est la capacité à laisser le corps être traversé par le plaisir sans se figer ni se contrôler. Cela suppose un bon ancrage et un climat de sécurité intérieure.
4. Démarche assertive
La manière de marcher, de se tenir, de se présenter traduit l’alignement entre l’identité, le sexe et la présence relationnelle. Une démarche assertive est ancrée, ouverte, fluide, investie. Elle reflète un corps qui ose exister.

