Médecine de la longévité : comment bien vieillir
Extrait d'un entretien par Guillaume PLEY (Legend) avec le Dr Christophe de Jaeger, médecin gérontologue et physiologiste, spécialisé dans l’étude de la sénescence humaine
1. Introduction : le médecin du temps qui passe
le Dr Christophe de Jaeger, médecin gérontologue et physiologiste, spécialisé dans l’étude de la sénescence humaine – autrement dit, le vieillissement – a consacré sa vie à comprendre ce processus pour aider chacun à bien vieillir, le plus longtemps possible, en restant actif, créatif, et capable d’aimer. »
GP : « Le sujet du vieillissement touche tout le monde, on est soixante-dix millions de Français, et dès qu’on a plus de six ans, on commence à s’y intéresser un peu ».
Dr CDJ : « Ce n’est pas tout à fait vrai. Beaucoup ne s’y intéressent pas encore, mais cela nous concerne tous. À cent pour cent. »

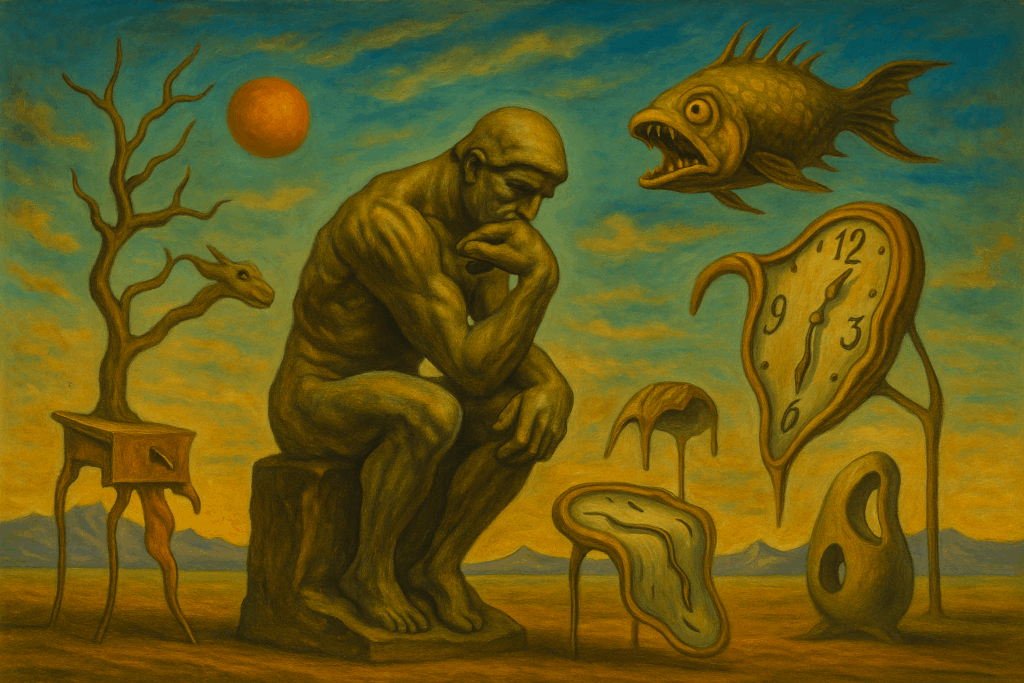
2. La sénescence : quand le développement devient déclin
« Le vieillissement, en réalité, commence dès la conception. Mais jusque vers la fin de l’adolescence, ce vieillissement est positif : il s’appelle développement. On grandit, on mûrit, on devient plus fort. Puis, à la fin de l’adolescence, nos systèmes biologiques commencent à se dégrader lentement, insidieusement. C’est là que débute la sénescence. »
Cette dégradation progressive fragilise l’organisme et ouvre la voie aux maladies chroniques, à la perte d’autonomie, puis à la mort.
Mais, précise-t-il, « on peut agir très tôt. Dès vingt ans, on peut être acteur de sa sénescence. »
3. Être acteur de son vieillissement
Le docteur insiste sur la notion de responsabilité :
« Il faut cesser de subir son capital santé comme un héritage figé. Nous en sommes les gestionnaires. Ce que nous faisons aujourd’hui aura des conséquences dans quinze, vingt ou trente ans. »
On peut comparer la santé à un livret d’épargne que les parents remettraient à leurs enfants : certains le dilapident en six mois, d’autres le font fructifier.
Le corps fonctionne selon la même logique : il faut savoir investir dans son futur biologique — par l’alimentation, l’exercice, la gestion du stress, le sommeil, et le sens que l’on donne à sa vie.

4. Génétique ou mode de vie : qui décide de notre vieillissement ?
« Pendant longtemps, explique-t-il, on pensait que tout était génétique. Quoi qu’on fasse, on serait prisonnier de nos gènes. Mais c’est faux. Aujourd’hui, on sait que la génétique ne compte que pour environ 20 % du vieillissement. Les 80 % restants dépendent de notre mode de vie. »
Autrement dit : la plupart de notre santé dépend de ce que nous faisons, pas de ce que nous sommes.
La biologie n’est pas un destin, c’est un terrain.
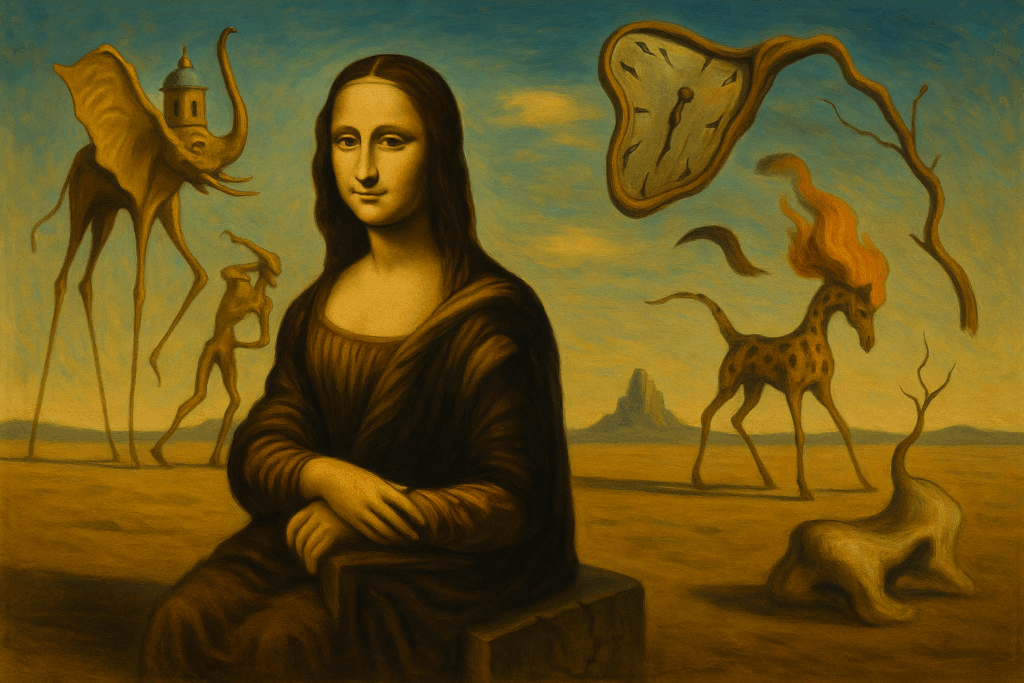
5. Le capital soleil et les marques du temps sur la peau
L’entretien bifurque vers les effets visibles du vieillissement. L’animateur évoque la fameuse notion de « capital soleil ».
Christophe de Jaeger confirme :
« Oui, c’est une réalité. Notre peau a une capacité limitée à encaisser les traumatismes du soleil. Ce capital varie selon les individus — les peaux claires, par exemple, sont plus fragiles. Quand il est épuisé, les lésions apparaissent : mélanomes, taches, rides… »
Il rappelle que le mélanome est l’un des cancers les plus redoutables, reconnaissable à un grain de beauté qui change d’aspect, s’étend ou devient noir.
Quant aux « taches de vieillesse », appelées lentigos, elles sont dues à une accumulation de déchets oxydés sous la peau : « Ce n’est pas grave, mais cela montre que la peau a atteint sa limite de tolérance. »

6. Les trois âges de la vie : chronologique, physiologique et ressenti
Dans son livre Médecine de la longévité, le docteur distingue trois âges :
- L’âge chronologique : c’est celui de la carte d’identité, l’âge administratif.
- L’âge physiologique : c’est l’âge réel de nos organes, mesurable grâce à des examens (état des artères, du cœur, du cerveau, de la peau…).
- L’âge ressenti : c’est celui que l’on croit avoir.
« La plupart des gens se sentent plus jeunes de dix à quinze ans que leur âge réel, explique-t-il. Mais cela crée une illusion. Comme on se compare à des gens en moins bonne santé, on se croit en pleine forme et on cesse de s’occuper de soi. »
Il observe que l’âge physiologique est souvent supérieur à l’âge chronologique : « On est biologiquement plus vieux que notre âge. »

7. Le meilleur âge du corps
Selon lui, le sommet physiologique se situe entre 20 et 25 ans, mais l’équilibre corps-esprit se trouve entre 30 et 50 ans :
« On a l’expérience, la maturité, et encore la santé. C’est une période d’or. Mais elle passe vite, happée par la vie professionnelle et familiale. Puis, à 50 ans, les premiers changements internes apparaissent : c’est le début des ennuis. Pas toujours visibles, mais bien présents. »
Chez les femmes, cette bascule est accélérée par la ménopause.
Les maladies silencieuses s’installent alors, souvent entre 50 et 60 ans, avant de s’exprimer pleinement entre 60 et 70.

8. Consultation de longévité : devenir acteur de sa santé
À la question « Que se passe-t-il lors d’une consultation ? », le docteur répond :
« Nous commençons par évaluer la demande. Nous refusons les fantasmes d’immortalité. Ensuite, nous établissons un bilan complet : âge physiologique des organes, paramètres sanguins liés à la sénescence, mais sans rechercher de maladies. C’est de la médecine de maintenance, comme pour une voiture : elle roule très bien, on veut qu’elle continue à rouler bien. »
Cette approche, dit-il, diffère de la médecine classique, centrée sur la maladie :
« Nous ne soignons pas, nous prévenons. »

9. Les télomères : horloge biologique de la cellule
L’entretien devient plus scientifique. Le journaliste évoque les télomères, ces petits capuchons situés à l’extrémité de l’ADN.
Christophe de Jaeger confirme :
« Les télomères, c’est le prix Nobel d’Elizabeth Blackburn. Chaque fois qu’une cellule se divise, un petit bout du télomère se perd. Quand il devient trop court, la cellule ne peut plus se diviser correctement : soit elle se suicide (apoptose), soit elle devient cancéreuse. »
Dans ce cas, explique-t-il, la cellule cancéreuse réactive des enzymes appelées télomérases, qui rallongent artificiellement les télomères et rendent la cellule “immortelle”.
« Donc oui, il existe un lien direct entre la longueur des télomères et la longévité. »

10. Peut-on rallonger ses télomères ?
Bonne nouvelle : oui.
« La longueur des télomères peut être influencée par notre mode de vie. La méditation, la relaxation, la réduction du stress ont un effet mesurable. L’exercice physique modéré aussi — mais attention, trop d’effort provoque l’effet inverse. »
Les télomères sont donc une mémoire de nos comportements. On peut les protéger, voire les rallonger, mais pas par des miracles : par la régulation du stress, la nutrition, l’activité et le sommeil.

11. Le stress, entre motivation et destruction
« Le bon stress n’est pas du stress, c’est de la motivation, précise-t-il. Le vrai stress, c’est le cortisol, l’hormone qui monte quand on subit une menace. Le problème, c’est qu’aujourd’hui nous ne pouvons plus “fuir ou combattre” : nous restons assis, bloqués dans nos tensions. Ce cortisol détruit nos cellules et raccourcit nos télomères. »
Ainsi, la gestion du stress est une véritable stratégie anti-vieillissement.
« Rire, aimer, méditer, respirer, ce sont des moyens puissants de prolonger sa jeunesse biologique. »

12. Les zones bleues : les centenaires du monde
Les zones bleues sont ces régions où la longévité est exceptionnelle : Okinawa (Japon), Sardaigne, certaines régions de Grèce, du Costa Rica ou de Californie.
« Ces gens n’ont pas de secret, dit-il. Ils mangent peu, bougent beaucoup, vivent dans des communautés soudées et ont un rôle social jusqu’à un âge avancé. Ils n’ont pas de stress existentiel, et surtout, ils ont un but. »
Les leçons d’Okinawa sont simples : sobriété, activité, lien social, et sens.

13. Les inégalités du vieillissement
« Nous ne vieillissons pas tous au même rythme, rappelle-t-il. Nous sommes biologiquement inégaux. Certains doivent lutter beaucoup plus pour maintenir leur santé. Le métabolisme, les hormones, le stress, tout cela varie d’un individu à l’autre. »
Ainsi, deux personnes peuvent manger la même chose et vivre différemment : l’une grossira, l’autre maigrira.
Le stress joue ici un rôle clé : il peut pousser le corps à stocker ou, au contraire, à brûler ses réserves selon le système nerveux activé.
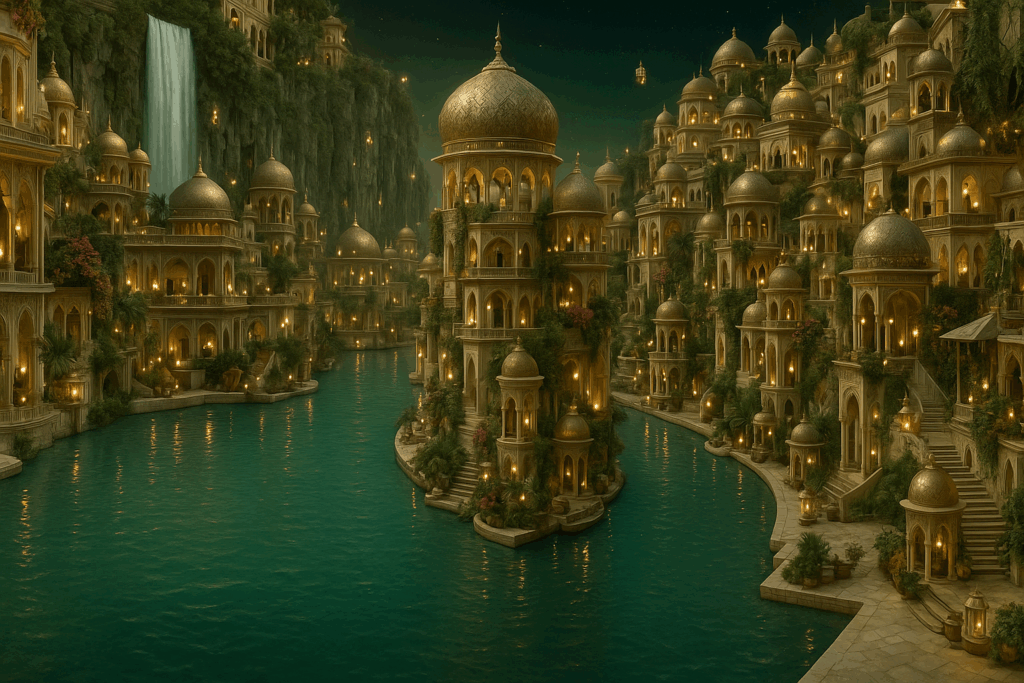
14. Les faux remèdes de la longévité : méfiance et discernement
Sur Internet, les promesses d’immortalité abondent.
« On parle d’inverser le vieillissement, de rajeunir les cellules, mais il faut garder la tête froide. Oui, on peut rendre des lignées cellulaires immortelles en laboratoire, mais un organisme vivant, c’est infiniment plus complexe. »
Le transhumanisme, cher à certains milliardaires, ne l’enthousiasme pas :
« Je n’ai pas envie d’être une machine. L’humain vieillit, c’est son équilibre. Le rêve d’une conscience transférée dans un robot, c’est une illusion d’ingénieur. »

15. Les facteurs accélérateurs du vieillissement
Le docteur de Jaeger les résume clairement :
- La suralimentation, surtout en sucres rapides.
- La sédentarité.
- Les toxiques : tabac, alcool, drogues.
- Le stress chronique.
- Le manque de sommeil.
Ces cinq éléments sont, selon lui, les vrais accélérateurs de sénescence.
À l’inverse, les corriger permet déjà de rallonger sa vie de plusieurs années.

16. Le rôle crucial du sommeil
« Le sommeil, c’est notre moment de réparation, dit-il. Le manque de sommeil est un fléau moderne. Les gens dorment moins, et mal. »
Il recommande :
- de dormir 7 à 8 heures par nuit,
- à heure régulière (même le week-end),
- dans une chambre sombre et fraîche (18-19°C),
- sans bruit ni lumière artificielle.
Dormir, c’est rajeunir : c’est durant le sommeil profond que le corps répare les tissus et équilibre les hormones.

17. Tabac et vieillissement accéléré
Le tabac, dit-il sans détour, détruit.
« Une cigarette suffit à abîmer vos artères. Une seule par jour augmente déjà le risque cardiovasculaire. »
Il explique que les maladies des artères commencent non pas par le cholestérol, mais par le sucre et l’inflammation de la paroi interne (l’endothélium). Le tabac aggrave ce processus.
« En arrêtant, on stoppe le risque, mais on ne régénère pas ce qui a été détruit. »
Il invite les fumeurs à ne pas se culpabiliser :
« Le but n’est pas d’ajouter du stress, mais d’aider le corps à s’en libérer. En travaillant sur d’autres aspects — activité, respiration, équilibre de vie —, l’envie de fumer finit souvent par disparaître. »
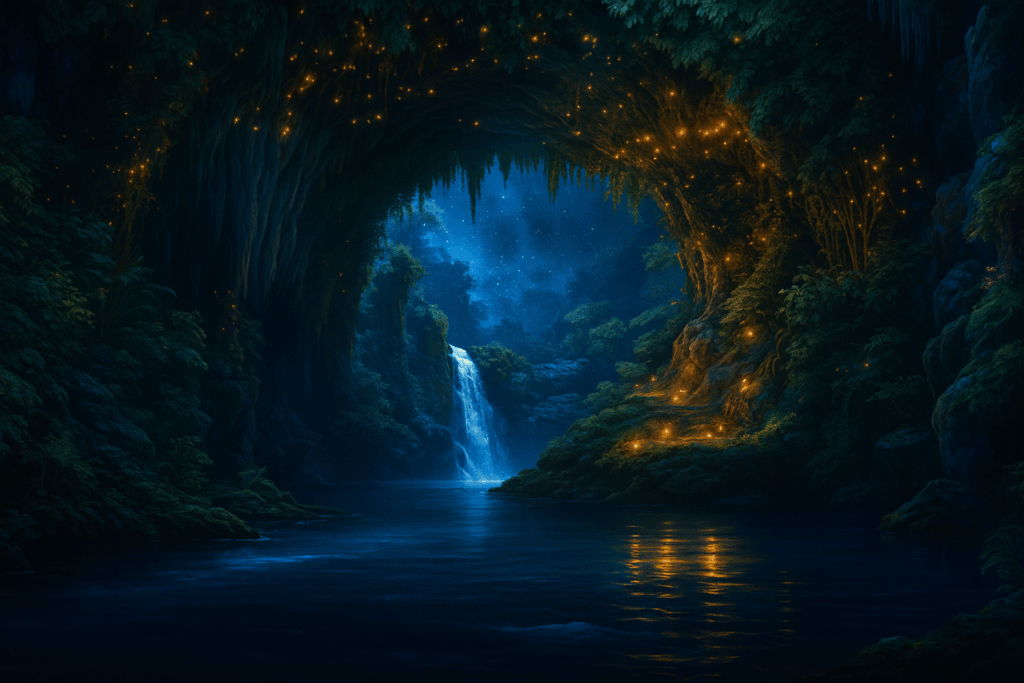
18. L’alcool : toxique mondain
Sur l’alcool, il est tout aussi clair :
« L’alcool est un toxique. Même modéré, il altère le foie, le cœur, les muscles, la peau. »
Le fameux “verre de vin rouge bon pour la santé” ?
« C’est le paradoxe français. Un mythe. Le resvératrol du vin rouge est protecteur dans un tube à essai, pas dans un organisme vivant. Il faudrait boire vingt litres par jour pour en tirer un effet bénéfique ! »
Une consommation ponctuelle et raisonnable n’est pas dramatique, mais la régularité, même faible, est délétère.

19. L’alimentation : moins, c’est mieux
Il confirme les bénéfices du jeûne intermittent :
« Ce n’est pas le jeûne en lui-même, mais le fait de manger moins. Notre société mange trop et trop sucré. Réduire les calories diminue le risque de diabète, d’inflammation et de maladies cardiovasculaires. »
Les centenaires, rappelle-t-il, mangent peu et simplement.
L’excès calorique, lui, use les cellules.
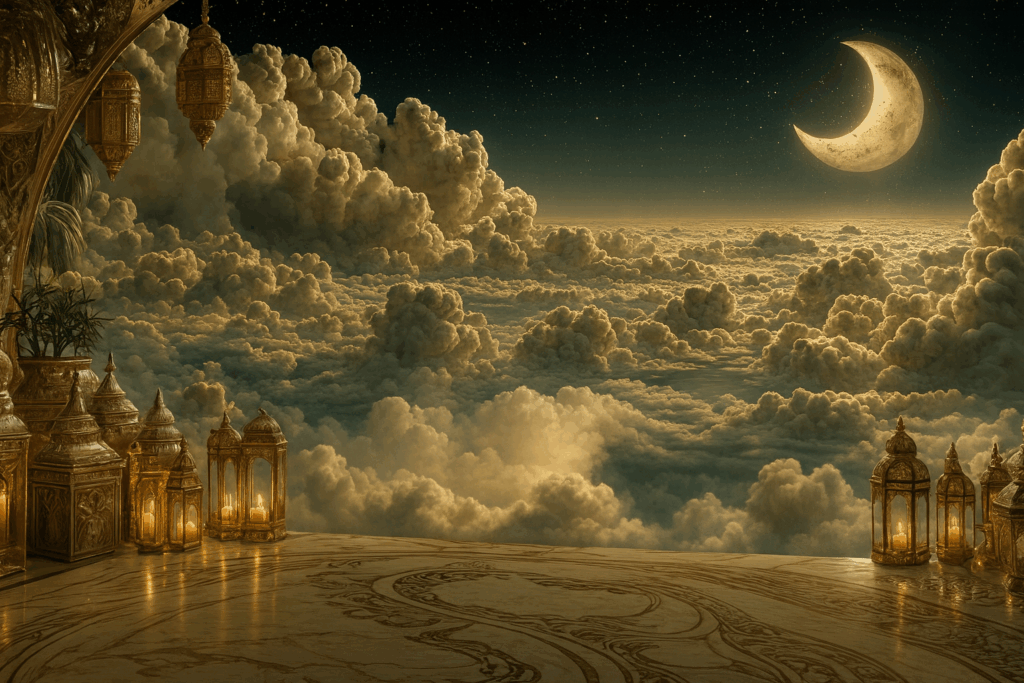
20. La médecine personnalisée : sortir de la moyenne
« En médecine, on raisonne trop souvent en moyenne, dit-il. Mais la moyenne n’existe pas. »
Chaque organisme a ses particularités.
« Appliquer une norme moyenne à un individu, c’est comme régler toutes les voitures d’un garage sur le même moteur : certaines explosent, d’autres ne démarrent plus. »
La médecine de la longévité se veut donc individualisée : connaître son corps, mesurer ses fragilités, adapter son mode de vie.
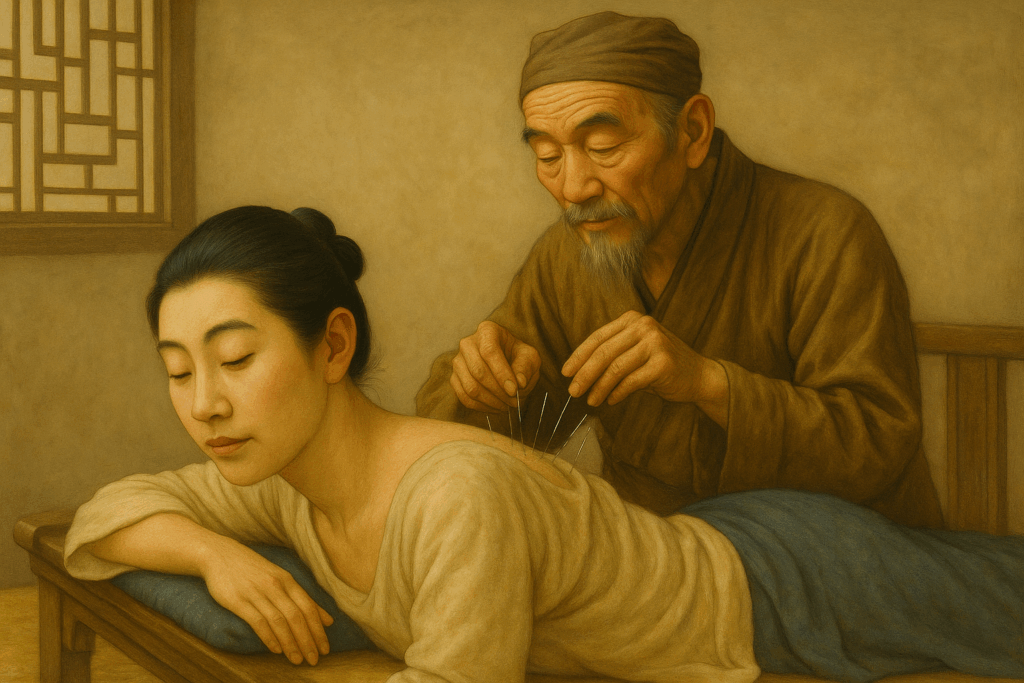
21. Compléments alimentaires : entre illusions et science
Le médecin passe en revue les grandes tendances :
- Collagène : utile pour la peau et les articulations, mais souvent détruit par l’estomac s’il n’est pas protégé.
- Acide hyaluronique : hydratant, mais d’efficacité variable.
- Resvératrol : non physiologique, efficacité non prouvée chez l’humain.
- Vitamine C, E, zinc : utiles si carence, mais à doses justes. Trop peut casser l’équilibre antioxydant.
- Ashwagandha, ginseng : plantes stimulantes, pas essentielles.
- Mélatonine : « L’un des rares produits vraiment utiles », dit-il.
Elle améliore le sommeil, soutient l’immunité et régule le moral, mais c’est une hormone — à doser et surveiller. - Spermidine : « effet prometteur in vitro, mais aucune preuve clinique. »
Sa conclusion est nette :
« Avant d’avaler quoi que ce soit, il faut connaître son statut biologique. Sinon, on fait du hasard. »
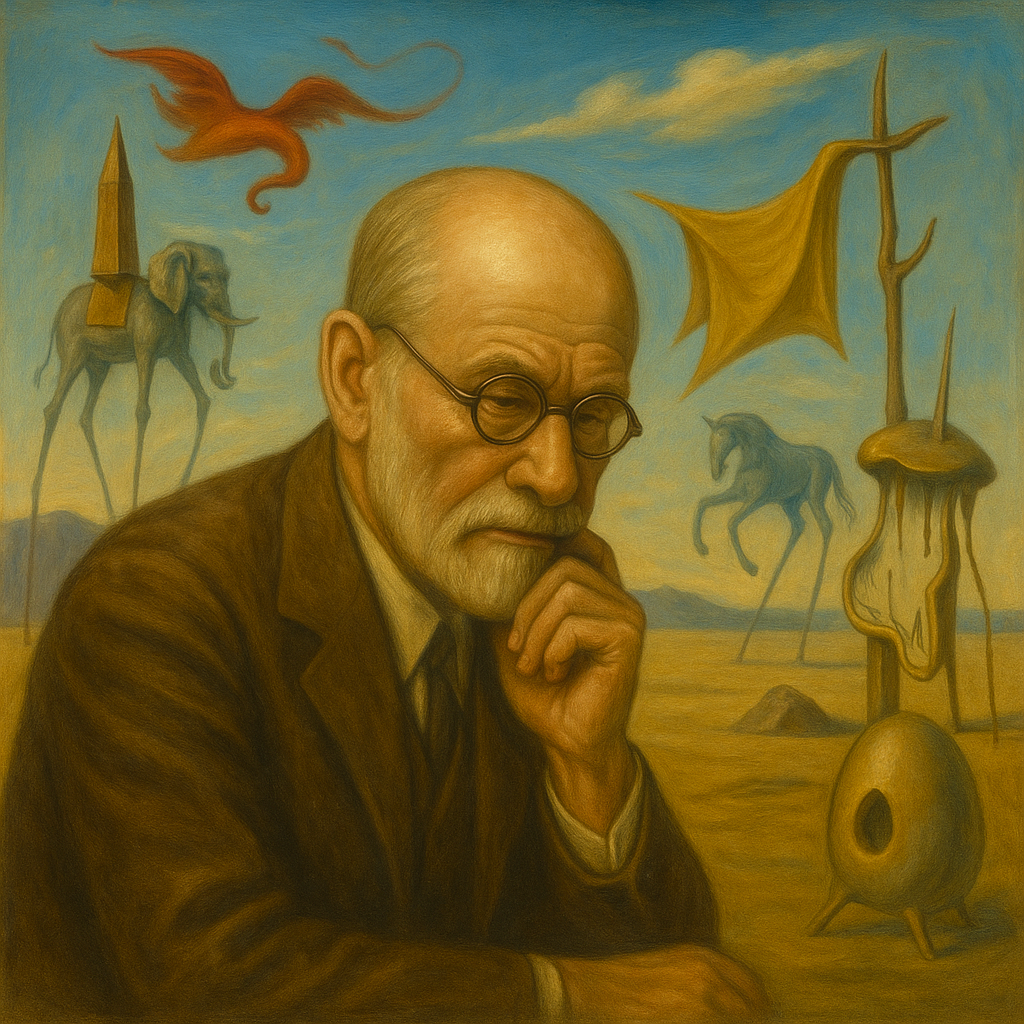
22. L’humour, l’amour, le sens : les vrais antioxydants
Rire, aimer, avoir un but : ces facteurs immatériels sont les plus puissants.
« Les gens qui vieillissent bien ont tous un projet. Le cerveau a besoin d’un objectif. Le jour où il n’en a plus, il se dégrade. »
Il raconte :
« Ma femme m’a dit un jour : “J’ai compris que tu ne prendras jamais ta retraite.” Et c’est vrai : tant qu’on a des raisons de se lever le matin, on reste vivant. »
Même constat pour la foi :
« Croire, c’est apaisant. Les croyants vivent souvent plus longtemps, car ils ont une sérénité face à la vie. »

23. Espérance de vie : l’histoire d’un progrès fragile
Le médecin retrace l’évolution :
- En 1740, l’espérance de vie était de 27 ans.
- En 1900, de 45 ans.
- En 1950, de 65 ans.
- Aujourd’hui, de 80 ans pour les hommes, 85 pour les femmes.
Mais ce progrès marque une pause.
« L’espérance de vie continue d’augmenter lentement, mais l’espérance de vie en bonne santé stagne. C’est ce qui doit nous alerter. »
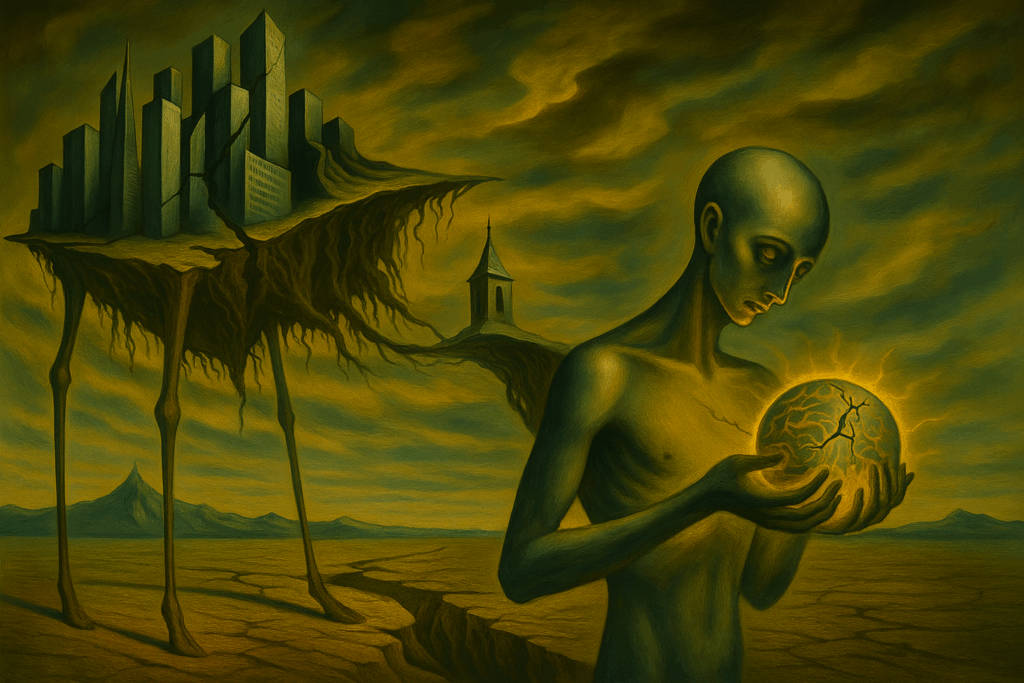
24. Pourquoi les femmes vivent plus longtemps
La différence de cinq ans entre les sexes intrigue.
« Les femmes sont mieux protégées par leurs hormones jusqu’à la ménopause, fument moins, boivent moins, et consultent plus. Leur vision de la santé est plus préventive. »
Les hommes, eux, « brûlent la bougie par les deux bouts ».

25. L’avenir de la médecine du vieillissement
« L’intelligence artificielle ouvre des pistes passionnantes, reconnaît-il. Elle aide à diagnostiquer plus vite, à repérer des signaux faibles. Mais ce n’est qu’un outil. La médecine de la longévité, c’est avant tout une médecine de terrain, du corps et du mode de vie. »
Peut-on vivre jusqu’à 150 ans ?
« Peut-être, un jour. Mais le vrai défi, c’est de vivre cent ans en bonne santé. Les centenaires passifs existent depuis toujours ; notre but, c’est de créer des centenaires actifs. »

26. Conclusion : bien vieillir, c’est bien vivre
« Bien vieillir, ce n’est pas refuser de vieillir. C’est faire de chaque année un temps de vitalité »

